Un glissement s’opère dans la façon de parler du réel. « Nicolas », « Tout le monde sait »… À mesure que certains sujets deviennent sensibles, judiciairement risqués ou moralement surveillés, ils ne disparaissent pas : ils mutent. Ce n’est plus le discours qui dit, c’est la formule. La société numérique produit ses aphorismes viraux, ses expressions-clés, ses idiomes mimétiques. Chaque mot devient un signe de ralliement. Ce n’est pas de la censure, c’est une transposition. Le langage se replie, se condense, et invente ses propres biais pour dire ce qu’il ne peut plus formuler frontalement.
« Nicolas qui paie » : le libéralisme en open source
« Nicolas qui paie » est devenu l’une des figures les plus reconnaissables de la rhétorique libérale sur les réseaux sociaux. L’image est fixe : un jeune homme, cravate défaite, visage dans les mains, soufflant sa détresse fiscale devant un écran flou. À première vue, c’est une banque d’image. Mais le contexte transforme tout. Nicolas est devenu un personnage : salarié du privé, sans réseau, sans subvention, sans niche. Il finance un modèle qui ne lui rend rien, ou si peu. Les retraites, les aides sociales, les subventions culturelles, les postes publics : tout passe par lui. Ou plutôt, par l’impôt qu’il paie sans retour équivalent.
De toutes les figures qui peuplent cette grammaire d’évitement, Nicolas est sans doute la plus aboutie. Il n’a pas été « inventé », il a émergé. Non pas comme un concept, mais comme un avatar collectif. C’est l’homme normal d’une société anormale. Celui qui remplit toutes les cases du contrat social, mais ne touche jamais les dividendes. Nicolas a 30 ou 35 ans. Il bosse dans une PME ou un cabinet de conseil. Il a une chemise à manches retroussées, une cravate mal nouée. Il prend le RER. Il ne fraude pas. Il paie ses impôts, ses amendes, son loyer, sa mutuelle. Il cotise.
Et c’est justement là que réside le cœur du mème : Nicolas cotise pour tout le monde, sauf pour lui. Il alimente un système qui lui échappe. Il paie pour Bernard et Chantal, couple de retraités baby-boomers, propriétaires de leur pavillon, naviguant de croisière Costa en cure thermale, cumulant pensions, exonérations et votes pour des candidats qui promettent de maintenir leurs avantages intacts. Il paie aussi pour Karim, 24 ans, quartier prioritaire, RSA, APL, CAF, emploi fictif en insertion, parfois petit trafic, parfois récidive. Jamais d’impôt, jamais de sanction réelle, et une clémence de la part des médias et du système.
Ces trois personnages — Nicolas, Bernard/Chantal, Karim — forment un triangle narratif, repris à l’infini dans les commentaires, les threads, les visuels. Nicolas, c’est l’effort sans récompense. Bernard, c’est le confort sans effort. Karim, c’est l’impunité avec subvention. C’est une fiction, mais elle s’impose comme un récit partagé. Elle ne prétend pas refléter la complexité, elle cristallise une perception. Et dans un univers saturé d’injustices perçues, la perception devient vérité opératoire.
Ce que dit « Nicolas qui paie », sans jamais le formuler explicitement, c’est l’exténuation silencieuse de la classe moyenne active. Celle qui n’a ni capital, ni réseau, ni héritage. Celle qui ne vit ni dans l’entre-soi bourgeois des centres-villes, ni dans les régimes de faveur des zones prioritaires. Cette France-là n’a pas de porte-parole. Elle n’a que Nicolas.
Et ce mème fait mouche parce qu’il déplace la charge. Il ne dit pas « je suis une victime », il dit « regardez-le, lui, ce type dans la banque d’image, il parle pour nous tous ». Il n’est pas plaintif. Il est désabusé, ironique, fatigué. Il permet de dire ce qu’un éditorial ne pourrait pas : que le système fonctionne à l’envers, que la redistribution n’a plus de légitimité, que l’État-providence ressemble de plus en plus à un parasite institutionnel. Le tout, sans jamais tomber sous le coup d’une accusation formelle.
Nicolas, c’est la version post-moderne du contribuable invisible. Ce n’est pas un slogan, c’est un miroir.
Derrière ce mème, toute une architecture idéologique s’installe. On n’a pas besoin de citer Bastiat, Hayek ou Sapir. Il suffit d’écrire « Nicolas ». Le reste est induit : dénonciation de la dépense publique, de l’inefficacité des services, de la solidarité forcée, de la confiscation fiscale. On peut y lire une critique globale du modèle français. On peut y entendre un appel implicite à la capitalisation, à la décentralisation, à l’individualisme méthodique. Le tout passe par un mème, donc par l’humour, donc par l’impunité.
« Tout le monde sait » : l’ellipse comme arme de dénonciation
« Tout le monde sait » est un autre bloc de langage, mais dans une direction politique distincte. Celui-ci fonctionne comme l’antithèse brute de Nicolas. Là où Nicolas incarne un excès de transparence — tout est dit, tout est chiffré, tout le monde est nommé —, « Tout le monde sait » repose sur l’opacité assumée. Ce n’est pas un argument, c’est un soupir. Une phrase qui suspend la conversation, qui clôt le débat sans jamais l’avoir ouvert. Ce n’est pas une thèse, c’est une intuition socialement partagée, esthétiquement cryptée, politiquement explosive.
Ici, ce n’est pas la charge fiscale qui est visée, mais l’immigration, les statistiques carcérales, les faits divers tordus, l’insécurité urbaine. L’expression n’affirme rien directement. Elle se contente d’énoncer l’évidence supposée d’un tabou : les origines des auteurs de certains crimes, leur surreprésentation dans les prisons, l’échec du modèle multiculturel. Popularisée par l’internaute « Bouli », incarné par le bonhomme de neige du dessin animé éponyme, « Tout le monde sait » est devenu un phénomène des réseaux.
Tout commence par un fait divers : agression à l’arme blanche, vol de portable, viol en réunion, voiture brûlée en banlieue, prison surpeuplée. Pas besoin de lire l’article. Il suffit du titre. En réponse, le mème : une image générée par IA — une pharmacie, un panneau LED, une devanture de kebab, ou le fameux bonhomme de neige — et cette phrase imprimée en lettres neutres, comme une publicité : « Tout le monde sait. »
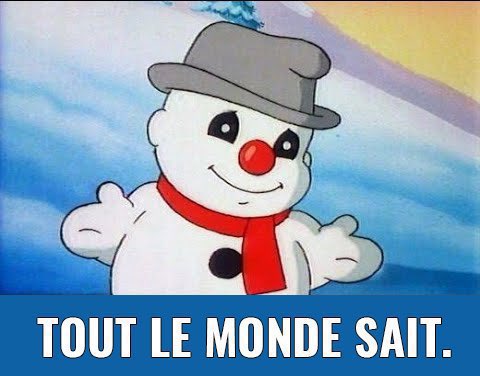
Le génie du mème tient dans cette forme : l’ellipse devient message. Le flou devient accusation. L’absence de sujet grammatical est la clé. Qui sait quoi ? On ne dit pas. On n’a pas besoin. Le lecteur complète de lui-même, avec ses propres représentations, ses propres statistiques, ses propres peurs. C’est une machine à produire du sous-entendu. Et dans cette économie de la suggestion, la charge idéologique est inversement proportionnelle à la longueur de la phrase.
Ce langage n’est pas seulement implicite. Il est rituel. Il est utilisé pour créer du lien entre ceux qui partagent un même diagnostic interdit. Ceux qui, à tort ou à raison, pensent que les élites, les médias, les institutions mentent ou taisent. « Tout le monde sait », c’est la réponse post-discursive à une époque où la parole est surveillée. Plus besoin de se justifier, de prouver, de démontrer : il suffit d’affirmer que « tout le monde » est déjà au courant. La vérité devient implicite, souterraine, presque sacrée. Elle n’a plus besoin d’être dite, elle doit simplement être reconnue.
Le phénomène est nourri par l’échec du débat sur l’immigration. Les faits sont connus, mais leur interprétation est interdite. Alors le langage se replie sur lui-même. « Tout le monde sait » devient une catharsis pour ceux qui pensent vivre dans un mensonge collectif. L’impression que les discours officiels contournent le réel, que la vérité est éclipsée par les précautions morales, que le bon sens est criminalisé.
Et dans cette logique, l’humour devient un bouclier. Les images absurdes — un footballeur levant les bras, une Capri Sun sur laquelle s’affiche la phrase, une IA qui écrit « Tout le monde sait » sur la Lune — ne servent pas à faire rire. Elles servent à détourner la censure. Plus le message est burlesque, plus il est indéchiffrable pour qui ne connaît pas le code. On parle à ceux qui savent que « tout le monde sait ».
Ce mème est un produit typique de la droite conservatrice contemporaine. Il ne cherche pas à convaincre l’extérieur. Il renforce l’intérieur. Il fédère par le soupçon, par le ressentiment partagé, par l’implicite. Il ne dit jamais « les immigrés sont responsables ». Il dit : « Tu sais ce que je ne peux pas dire. »
Et ça suffit.
L’expression n’a pas besoin d’argument. Elle crée un effet de complicité, d’aveu silencieux, de vérité étouffée. Elle opère sur le mode du soupçon partagé. Elle suggère ce qu’elle ne dit pas. Et ce silence est précisément son efficacité.
La dérision, dernier refuge discursif de la droite
Ces deux syntagmes appartiennent à la même galaxie politique : celle de la droite numérique, mais pas à la même planète. « Nicolas » est un mème libéral. Il défend l’effort individuel, l’allègement fiscal, la performance. « Tout le monde sait » est un mème conservateur. Il s’inscrit dans une critique des effets de l’immigration, de la permissivité judiciaire, de la dislocation culturelle. L’un dénonce l’État, l’autre dénonce la société. L’un regarde vers le portefeuille, l’autre vers l’identité. Parfois, certains « savent » et « sont Nicolas ». Mais pas tous.
Ils ne sont pas nécessairement compatibles. On peut vouloir la baisse des impôts et l’ouverture des frontières. On peut exiger la fermeture des frontières et plus de redistribution sociale. Mais dans l’espace numérique, ces contradictions se suspendent. Ce n’est pas la cohérence idéologique globale qui prime, c’est la contagion virale des formules. Ce qui circule, ce n’est pas une pensée, mais une reconnaissance mutuelle.
Le langage codé prospère d’abord à droite, parce qu’il repose sur une ironie partagée. À gauche, le discours reste plus explicite, plus normatif, plus institutionnel. Il produit des tribunes, des appels, des indignations structurées. Il ironise moins, rit peu, et se prend au sérieux. La droite numérique, elle, a compris que l’humour permet de faire passer l’illégitime sous le masque du légitime. Qu’on ne peut pas interdire une blague. Que les codes permettent d’aller plus loin que les discours.
Ce que révèlent “Nicolas qui paie” et “Tout le monde sait”, c’est moins l’état de l’opinion que l’état du langage politique dans une société de surveillance normative et de saturation symbolique. Lorsque les mots sont piégés, les esprits inventent des chemins de traverse. Ce ne sont pas des slogans : ce sont des protocoles de communication en régime de soupçon. Des codes partagés dans des bulles informationnelles où la connivence remplace l’argumentation, où l’ironie protège du procès, où la réduction visuelle vaut pour démonstration.
Le politologue Jean-Yves Dormagen l’a formulé autrement : « on n’a jamais autant parlé de politique, mais rarement aussi peu politiquement ». L’idéologie se déplace dans les images, dans les private jokes, dans le sous-texte. L’espace public devient un espace crypté, où chaque groupe parle en circuit fermé, avec ses icônes, ses mots de passe, ses figures tutélaires. À gauche, peu d’équivalents : la logique du discours structuré, de l’argument rationnel, de la posture morale y reste dominante. Mais dans la sphère droitière — libérale ou conservatrice — la dynamique est inversée : plus l’idée est risquée, plus elle se dit à travers un écran de dérision.
Ce type de langage est celui d’une époque de transition. Celle où la liberté d’expression est toujours légalement garantie, mais culturellement encadrée. Où l’on peut parler de tout, à condition de bien choisir ses mots. Où la vérité ressentie devient une vérité cryptée, et où la puissance d’un message tient à son opacité délibérée.
Reste cette question ouverte, inquiétante :
Que devient un pays dont les citoyens ne se parlent plus qu’à mots couverts ?

Ping : PSG-Arsenal : Victoire en surface, effondrement en profondeur - Inner Line - Billets & Analyse
Ping : La fiction du meilleur système de santé au monde - Inner Line - Billets & Analyse
Ping : La fiction du meilleur système de santé au monde - Inner Line - Billets & Analyse