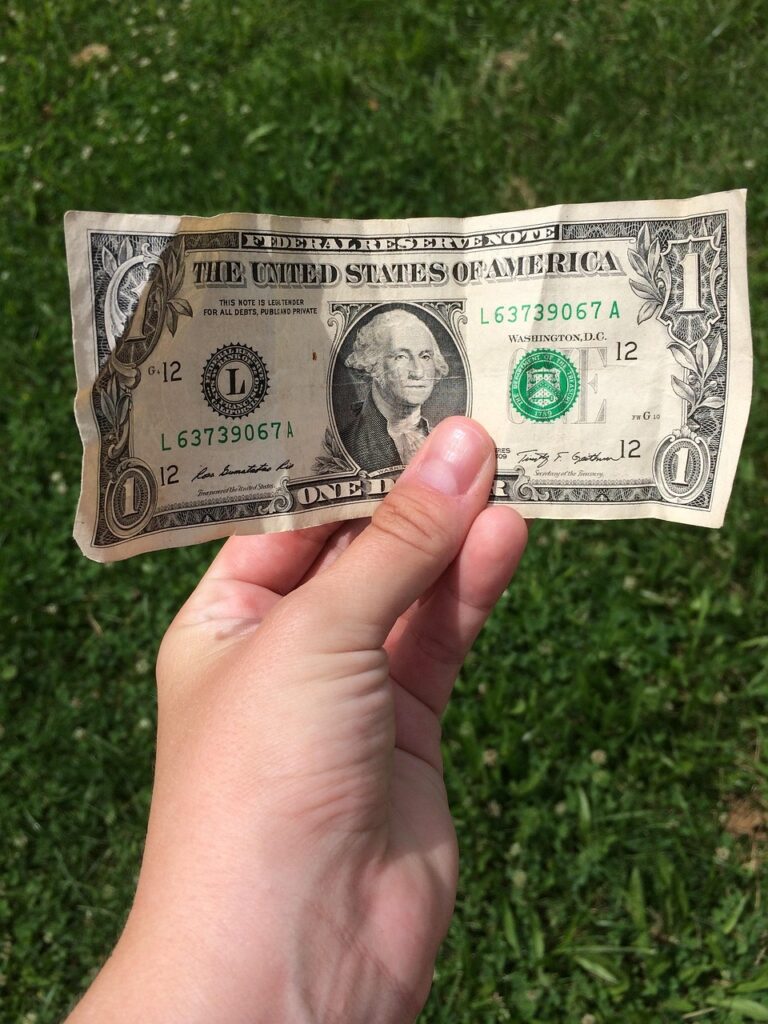La baisse actuelle du dollar n’est pas un bruit de marché. C’est une ligne de fracture. Le dollar ne chute jamais seul : il entraîne avec lui un système mondial construit sur son hégémonie. Chaque affaiblissement apparent du billet vert ouvre la question de sa fonction stratégique.
Instrument de domination
Depuis 1944, le dollar n’est pas seulement une unité de compte mais une architecture impériale. Sa force impose au monde une dépendance forcée : énergie facturée, dettes contractées, contrats sécurisés. Sa faiblesse, au contraire, agit comme un transfert de puissance. Un dollar qui baisse, c’est une redistribution silencieuse des coûts et des marges. Les exportateurs américains retrouvent un avantage. Les créanciers étrangers sont pénalisés. L’Amérique achète plus cher, mais vend plus facilement.
La Maison Blanche ne publie pas de décret annonçant la dépréciation du dollar. Mais chaque administration a joué de ce levier, parfois brutalement. Le discours protectionniste de Trump est cohérent avec un dollar plus faible. L’objectif est double : soutenir la Bourse dans l’immédiat, afficher des chiffres d’exportations favorables, renforcer le discours nationaliste de réindustrialisation. La baisse est donc moins un accident qu’une tolérance.
La Bourse comme théâtre
Un dollar bas dope mécaniquement les revenus des multinationales américaines. Les marchés applaudissent. Les indices grimpent. Mais l’effet est trompeur : la hausse des cours ne traduit pas une productivité retrouvée, seulement un effet de change. L’économie réelle reste sous les mêmes contraintes de coût et de dette. Le marché, pourtant, n’y voit qu’un signal haussier.
Les obligations américaines représentent le socle de la finance mondiale. Un dollar faible érode la valeur de ce socle pour les investisseurs étrangers. La Chine, le Japon, les fonds souverains du Golfe encaissent une perte invisible. À long terme, cette érosion mine la confiance dans le Trésor américain. Elle force une prime de risque. Elle amorce la tentation de diversifier vers l’or, l’euro, ou même le yuan. C’est là que la manœuvre cesse d’être économique pour devenir géopolitique.
Commerce international sous pression
Un dollar bas est une forme de protectionnisme déguisé. L’Europe et l’Asie sont forcées de choisir : laisser leurs devises monter, et donc sacrifier leurs exportateurs, ou entrer dans une spirale de dévaluations compétitives. Les règles de l’OMC deviennent alors obsolètes. Le dollar en repli agit comme un coup de boutoir dans l’architecture multilatérale.
L’euro grimpe. Le yen grimpe. Les monnaies émergentes hésitent. Certaines suivent le dollar vers le bas, risquant d’alimenter l’inflation locale. D’autres se maintiennent haut, au prix d’une récession exportatrice. Le choix est toujours perdant : subir ou s’affaiblir. Le dollar déplace le coût de sa propre baisse sur les autres monnaies.
Tourisme et flux secondaires
Un dollar bas attire les touristes. Les Européens consomment davantage aux États-Unis, les Chinois achètent plus facilement du luxe américain. Mais la classe moyenne américaine paie plus cher ses voyages à l’étranger, se replie sur le marché intérieur. C’est un micro-signal d’une tendance plus large : recentrage, isolement, autoconsommation.
Un dollar qui s’affaiblit ne reste jamais stable. Soit la baisse s’accélère et fracture la confiance mondiale, forçant une réorganisation brutale. Soit elle est stoppée par une intervention de la Fed, au prix d’un retournement violent. La baisse est une arme à double tranchant : bénéfique dans le court terme électoral, corrosive à long terme pour l’empire monétaire.
La tension
Un dollar trop fort tue l’industrie américaine. Un dollar trop faible mine sa crédibilité impériale. Le pouvoir joue entre ces deux abîmes. La baisse actuelle n’est pas une fin. C’est un signal.